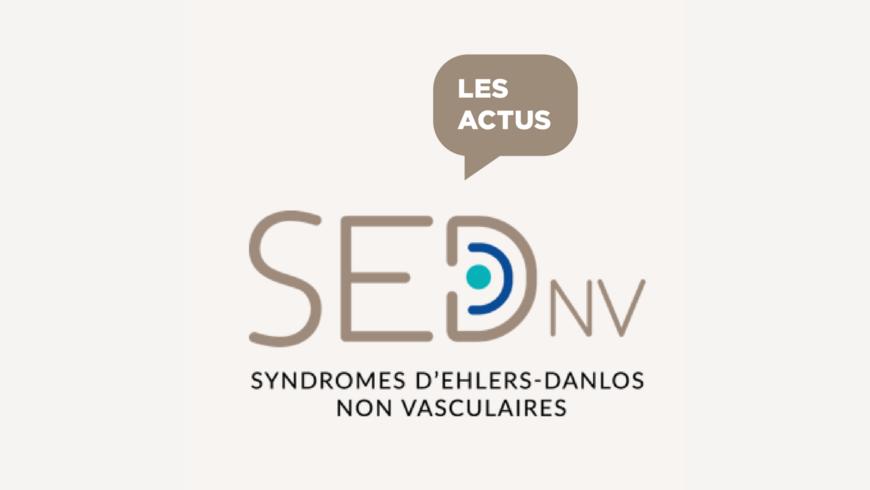Actu MOC - juillet 2025

Sommaire
🔎 Maladies d'Ollier-Maffucci : avancées cliniques, génétiques et thérapeutiques
🔎 Recommandations internationales de surveillance oncologique
🔎 Premier traitement ciblé IDH1 par ivosidenib chez un patient Maffucci
🔎 Une nouvelle hypothèse physiopathologique : la théorie de la triple interaction
🔎 Vers des traitements ciblés IDH2 : enasidenib et chondrosarcomes
🔎 Chirurgie orthopédique : clous d’allongement intramédullaires
🔎 Troubles du sommeil et achondroplasie : cinq principes européens pour guider la prise en charge
🔎 Un nouveau gène impliqué dans une dysplasie squelettique avec dislocations multiples
🔎 Grossesse et ostéogenèse imparfaite : quelles complications maternelles et fœtales ?
🔎 Mucoviscidose : la mutation CFTR altère la différenciation ostéoblastique
Maladies d'Ollier-Maffucci : avancées cliniques, génétiques et thérapeutiques
Les maladies d’Ollier (enchondromatose multiple) et de Maffucci sont des maladies rares du squelette liées à un mosaïcisme somatique, le plus souvent dû à une mutation acquise du gène IDH1 ou IDH2. Elles se caractérisent par la présence de multiples enchondromes (tumeurs cartilagineuses bénignes intramédullaires) pouvant entraîner des déformations osseuses, une inégalité de longueur des membres, et un risque accru de transformation maligne, principalement en chondrosarcome. Le syndrome de Maffucci se distingue par l’association à des hémangiomes des tissus mous. Les deux syndromes sont aujourd’hui considérés comme des syndromes de prédisposition tumorale.
Recommandations internationales de surveillance oncologique
Un consensus international publié en 2024 par l’AACR (American Association for Cancer Research) a établi de nouvelles lignes directrices pour la surveillance des syndromes de prédisposition au cancer chez l’enfant, incluant les maladies d’Ollier et de Maffucci. Il est désormais reconnu que jusqu'à 50 % des patients peuvent développer une tumeur maligne (principalement un chondrosarcome) au cours de leur vie. Le consensus recommande une IRM corps entier de référence suivie d’un contrôle régulier ciblant les signes de transformation maligne (croissance rapide d’un enchondrome, douleurs persistantes). Cette stratégie vise à un dépistage précoce afin d’améliorer la prise en charge.
Pour en savoir + : Update on Cancer Screening in Children with Syndromes of Bone Lesions, Hereditary Leiomyomatosis and Renal Cell Carcinoma Syndrome, and Other Rare Syndromes.
Michaeli O, Kim SY, Mitchell SG, Jongmans MCJ, Wasserman JD, Perrino MR, Das A, MacFarland SP, Scollon SR, Greer MC, Sobreira N, Gallinger B, Lupo PJ, Malkin D, Schneider KW, Schultz KAP, Foulkes WD, Woodward ER, Stewart DR.Clin Cancer Res. 2025 Feb 3;31(3):457-465.
Premier traitement ciblé IDH1 par ivosidenib chez un patient Maffucci
Une équipe française du centre de référence constitutif des maladies osseuses constitutionnelles (MOC), à l’hôpital Lariboisière AP-HP, a rapporté en 2024 le premier cas traité par ivosidenib, un inhibiteur ciblant la mutation IDH1, chez un patient atteint de syndrome de Maffucci. Ce patient présentait un gliome cérébral récidivant IDH1-R132H et de multiples enchondromes douloureux. Sous ivosidenib (médicament déjà approuvé en leucémie AML IDH1 mutée et en cholangiocarcome), le gliome a montré une stabilisation de volume, et fait marquant, les lésions d’enchondromatose ont significativement diminué de volume et gagné en dureté, s’accompagnant d’une réduction notable des douleurs osseuses. Des radiographies ont objectivé une amélioration de la minéralisation des enchondromes sous traitement. Ce résultat encourageant suggère pour la première fois qu’une thérapie ciblée par inhibition d’IDH1 pourrait avoir un impact direct sur les manifestations osseuses du syndrome d’Ollier-Maffucci.
Les auteurs appellent à des recherches cliniques supplémentaires pour évaluer le rapport bénéfice/risque à long terme des inhibiteurs d’IDH dans ces maladies rares.
Pour en savoir + : Clinical and radiological response of Maffucci related enchondromas to mutant IDH1 inhibitor Ivosidenib.
Funck-Brentano T, Cohen-Solal M, Ducray F, Mandonnet E.Bone. 2024 Nov;188:117221.
Une nouvelle hypothèse physiopathologique : la théorie de la triple interaction
Des chercheurs français ont proposé une modélisation originale du développement tumoral chez les patients atteints d’Ollier-Maffucci. Selon cette « théorie de la triple interaction », trois facteurs doivent coexister pour permettre la survenue d’une tumeur IDH-mutée : une mutation IDH mosaïque post- zygotique précoce, un contexte microenvironnemental tissulaire propice, et une prédisposition génétique germinale. Cette hypothèse explique que malgré la présence ubiquitaire d’une mutation IDH mosaïque, seules certaines cellules/tissus développent des tumeurs (ex. gliome du système nerveux, chondrosarcome des os, hémangiome des tissus mous) en raison d’un terrain permissif et d’une co-prédisposition génétique spécifique.
La théorie de la triple interaction ouvre de nouvelles perspectives de recherche, suggérant de rechercher chez les patients Ollier-Maffucci des facteurs génétiques constitutionnels modulant le risque de chaque type tumoral, et d’adapter le suivi en conséquence.
Pour en savoir + : Spectrum of IDH-mutant tumors in Ollier-Maffucci disease: the triple interaction theory.
Mandonnet E, Funck-Brentano T, Hugnot JP, Touat M.Orphanet J Rare Dis. 2024 Nov 25;19(1):434.
Vers des traitements ciblés IDH2 : enasidenib et chondrosarcomes
Dans le prolongement des thérapies ciblant IDH1, une équipe hispano-néerlandaise a exploré une approche de médecine personnalisée pour les chondrosarcomes porteurs de mutation IDH2.
En mars 2024, ils ont montré sur des modèles précliniques qu’énasidenib (AG-221, un inhibiteur oral spécifique d’IDH2 muté, déjà autorisé en hématologie) induit une forte inhibition proliférative dans des cellules de chondrosarcome IDH2-muté. L’étude, publiée dans EBioMedicine, suggère que l’énasidenib pourrait constituer une alternative thérapeutique efficace pour les chondrosarcomes avec IDH2 mutant. Ce résultat est particulièrement pertinent pour les formes syndromiques Ollier- Maffucci lorsqu’elles évoluent en chondrosarcome, car ~20 % des cas sont liés à des mutations IDH2 (vs ~80 % IDH1). Parallèlement, un essai clinique de phase II commandité par BMS (Bristol-Myers Squibb) évalue actuellement l’énasidenib dans les chondrosarcomes avancés (IDH2) (il était en cours en 2024-2025). Ces avancées témoignent d’un mouvement de repositionnement de traitements oncologiques initialement conçus pour les leucémies/gliomes vers les tumeurs osseuses des patients Ollier-Maffucci.
À terme, cela laisse espérer des options médicales ciblées, là où la chirurgie et la surveillance étaient jusqu’ici les seules approches en cas de transformation maligne.
Pour en savoir + : A personalized medicine approach identifies enasidenib as an efficient treatment for IDH2 mutant chondrosarcoma.
Rey V, Tornín J, Alba-Linares JJ, Robledo C, Murillo D, Rodríguez A, Gallego B, Huergo C, Viera C, Braña A, Astudillo A, Heymann D, Szuhai K, Bovée JVMG, Fernández AF, Fraga MF, Alonso J, Rodríguez R.EBioMedicine. 2024 Apr;102:105090.
Chirurgie orthopédique : clous d’allongement intramédullaires
Sur le plan de la prise en charge orthopédique, une étude multicentrique française (Angers, Paris- Necker, Rennes, Bordeaux, Grenoble) publiée en 2024 a évalué une nouvelle approche chirurgicale pour corriger les inégalités de longueur des membres chez des enfants atteints d’enchondromatose (Ollier ou Maffucci). Historiquement, ces déformations étaient traitées par fixateurs externes, au prix de complications fréquentes (infections de broches, raideurs articulaires, fractures).
Les chirurgiens ont testé l’allongement osseux intramédullaire motorisé (clou PRECICE®) sur 8 patients (10 segments osseux longs) âgés de 11 à 16 ans.
Tous les objectifs d’allongement ont été atteints, sans complications majeures. De plus, une amélioration de la minéralisation des enchondromes a été observée dans 80 % des segments osseux traités.
Les auteurs concluent que les clous d’allongement internes constituent une alternative sûre et efficace aux fixateurs externes, avec en prime un effet thérapeutique sur les enchondromes eux-mêmes (phénomène de régénération osseuse possiblement stimulé par l’alésage). Cette approche pourrait changer les standards chirurgicaux chez les jeunes patients Ollier-Maffucci en réduisant les séquelles orthopédiques.
Bonneau S, Georges S, Fraisse B, Haumont E, Lefèvre Y, Bremond N, Pejin Z, Violas P. SICOT J. 2024;10:43.
Troubles du sommeil et achondroplasie : cinq principes européens pour guider la prise en charge
Les personnes atteintes d’achondroplasie présentent un risque accru de troubles respiratoires du sommeil (TRS), en raison d’anomalies anatomiques craniofaciales caractéristiques. Ces troubles incluent principalement :
- l’apnée obstructive du sommeil (AOS),
- plus rarement l’apnée centrale (ACS)
- et l’hypoventilation alvéolaire nocturne (HAV).
Ils peuvent survenir à tout âge, dès la petite enfance, et sont associés à des conséquences importantes : troubles cognitifs, complications cardiovasculaires et métaboliques, fatigue chronique et altération de la qualité de vie.
Vers un consensus européen
Pour améliorer l’évaluation et la prise en charge de ces troubles, le European Achondroplasia Forum (EAF) a réuni en octobre 2023, 40 experts multidisciplinaires et représentants des associations de patients à l’occasion d’un atelier virtuel. Ensemble, ils ont élaboré cinq principes directeurs pour guider la gestion des TRS dans l’achondroplasie.
Les 5 principes adoptés (consensus 100 %) :
- Surveillance tout au long de la vie
Le dépistage des TRS doit être intégré dans le suivi régulier, de l’enfance à l’âge adulte. - Dépistage systématique
Reposant sur l’interrogatoire, l’examen clinique, et des outils de triage standardisés pour identifier les symptômes évocateurs. - Études du sommeil adaptées
Une polysomnographie ou polygraphie doit être proposée en cas de suspicion, avec des protocoles individualisés. - Approche thérapeutique graduée
Incluant les mesures non invasives (surveillance, ventilation nocturne), les traitements chirurgicaux si nécessaire (ex. adéno-amygdalectomie), et une coordination spécialisée. - Prise en charge multidisciplinaire centrée sur la personne
Coordination entre généticiens, pédiatres, pneumologues, ORL, kinésithérapeutes, avec implication active du patient et de sa famille.
Tous ces principes ont reçu un niveau d’accord élevé, soulignant un fort consensus sur la nécessité d’une prise en charge structurée, proactive et individualisée des TRS dans l’achondroplasie.
Pour en savoir + : Management of sleep-disordered breathing in achondroplasia: guiding principles of the European Achondroplasia Forum.
Fauroux B, AlSayed M, Ben-Omran T, Boero S, Boon M, Cormier-Daire V, Fredwall S, Guillen-Navarro E, Irving M, Kunkel P, Madureira N, Maghnie M, Milerad J, Mohnike K, Mortier G, Nobili L, Pejin Z, Sessa M, Sousa SB.Orphanet J Rare Dis. 2025 May 15;20(1):233.
Un nouveau gène impliqué dans une dysplasie squelettique avec dislocations multiples
Dans un article publié en mars 2025 dans le Journal of Bone and Mineral Research, une équipe dirigée par Valérie CORMIER-DAIRE (CRMR MOC, hôpital Necker-Enfants Malades, AP-HP) identifie DDR1 comme un nouveau gène responsable de dysplasie squelettique sévère à dislocations multiples. Ce travail s'inscrit dans la continuité des efforts visant à élargir le spectre moléculaire des chondrodysplasies rares, et s’appuie sur l’analyse exomique de plusieurs patients issus de familles consanguines.
L’étude met en évidence une mutation homozygote perte-de-fonction du gène DDR1, codant un récepteur tyrosine kinase exprimé à la surface des chondrocytes et impliqué dans la signalisation extracellulaire. Les analyses fonctionnelles démontrent que cette mutation entraîne une altération de la production de protéoglycanes dans le cartilage de croissance, ainsi qu’une dérégulation de la voie de signalisation IHH (Indian Hedgehog), essentielle à la prolifération et à la différenciation des chondrocytes.
Sur le plan phénotypique, les patients présentaient une hyperlaxité articulaire majeure, des luxations multiples congénitales (hanches, genoux) et une hypoplasie cérébelleuse, suggérant un effet systémique de DDR1 au-delà du cartilage articulaire. L’histologie et l’immunohistochimie confirment une désorganisation sévère de la plaque de croissance.
Cette découverte positionne DDR1 comme un nouveau gène causal de chondrodysplasie avec dislocations multiples, élargissant le spectre génétique de ces pathologies (jusqu’ici dominé par des gènes comme B3GAT3, CHST3, CANT1). Elle ouvre également des perspectives de recherche sur la modulation pharmacologique des voies de signalisation perturbées.
Pour en savoir + : Loss-of-function of DDR1 is responsible for a chondrodysplasia with multiple dislocations.
Villegas Villarroel M, Huber C, Baujat G, Bonnard A, Collet C, Cormier-Daire V.J Bone Miner Res. 2025 Mar 15;40(3):362-371.
Grossesse et ostéogenèse imparfaite : quelles complications maternelles et fœtales ?
Une étude nationale française, publiée récemment dans Obstetrics & Gynecology, a évalué les complications maternelles et fœtales associées à l’ostéogenèse imparfaite (OI) à partir de plus de 8,8 millions de grossesses recensées entre 2012 et 2023.
Parmi celles-ci, 408 grossesses ont concerné des femmes atteintes d’OI (prévalence : 4,6/100 000). Comparées à la population générale, ces patientes présentaient des risques significativement accrus de :
- Hémorragie antepartum
- Chorioamniotite
- Malprésentation fœtale
- Accouchement prématuré
- Césarienne, y compris chez les nullipares
Sur le plan fœtal, l’OI maternelle était associée à une augmentation du risque d’anomalies congénitales majeures, notamment cardiaques, même après exclusion des cas d’OI néonatale. En revanche, aucune augmentation du taux de fractures maternelles post-partum n’a été observée.
Ces données confirment que la grossesse chez les femmes atteintes d’OI nécessite une prise en charge spécialisée et multidisciplinaire, incluant une évaluation préconceptionnelle, un suivi obstétrical renforcé et une planification individualisée de l’accouchement.
Pour en savoir + : Pregnancy-Related Complications in Osteogenesis Imperfecta.
Obstet Gynecol. 2025 Jun 5. doi: 10.1097/AOG.0000000000005957.
Mucoviscidose : la mutation CFTR altère la différenciation ostéoblastique
Une étude publiée en janvier 2025 dans le Journal of Cystic Fibrosis, co-signée par Frédéric VELARD (laboratoire BIOS, Université de Reims Champagne-Ardenne), met en lumière un mécanisme cellulaire potentiel expliquant les atteintes osseuses observées chez les patients atteints de mucoviscidose. Cette maladie rare autosomique récessive, causée par des mutations du gène CFTR, est principalement connue pour ses atteintes pulmonaires et pancréatiques. Toutefois, une ostéopathie cystique spécifique est fréquemment rapportée, en particulier chez les adolescents et jeunes adultes.
L’équipe de recherche montre que la mutation CFTR perturbe significativement la différenciation des ostéoblastes, cellules responsables de la formation osseuse. Les cellules porteuses de mutations présentent une altération de l’expression de marqueurs ostéogéniques clés (RUNX2, OCN, ALP) et une capacité réduite à former une matrice minérale fonctionnelle in vitro.
Ces résultats suggèrent que la déficience osseuse dans la mucoviscidose n’est pas uniquement secondaire aux carences nutritionnelles, à l'inflammation chronique ou à la corticothérapie prolongée, mais pourrait également résulter d’un effet intrinsèque de la mutation CFTR sur les cellules osseuses elles-mêmes.
Cette avancée ouvre la voie à de nouvelles approches de prévention et de traitement de l’ostéopathie associée à la mucoviscidose, ciblant directement les anomalies de différenciation ostéoblastique.
Pour en savoir + : CFTR mutation is associated with bone differentiation abnormalities in cystic fibrosis.
Dumortier C, Frauenpreis A, Hoarau A, Ryan AL, Gangloff SC, Danopoulos S, Velard F, Al Alam D.J Cyst Fibros. 2025 Jan 11:S1569-1993(25)00005-0.